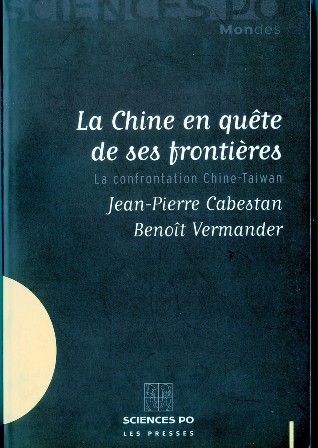Anquan sécurité (p.57) Guojia anquan : sécurité nationale; Guoji anquan : sécurité internationale
La recherche d'un style diplomatique conciliant et rassurant ne saurait en aucun cas s'assimiler à un relâchement de l'obligation d'assurer la sécurité (anquan) du pays. La définition de ce à quoi correspond la sécurité nationale est particulièrement développée et englobante.
On en trouve une analyse détaillée dans un article intitulé « Au sujet de la vision de la sécurité nationale de Jiang Zemin », lequel reprend peu ou prou tous les textes disponibles sur le sujet. Il vaut la peine d'en faire un bref résumé : Assurer la sécurité nationale est la pierre de touche de l'existence et du développement de la nation.
Cette tâche s'exerce désormais dans un contexte international en voie de multipolarisation et de mondialisation.
Le chemin vers la multipolarisation ne va pas sans luttes, lesquelles expliquent les recompositions politiques aujourd'hui en cours.
L'hégémonisme s'exprime par les tentatives faites pour favoriser l'« occidentalisation » et la « division » à l'intérieur de la Chine, et, de ce fait, pour l'affaiblir.
La complexité du conflit de long terme avec l'hégémonisme occidental exige de la part de la Chine de savoir développer un « art de la lutte » (douzheng yishu).
Ces préoccupations justifient l'accent porté sur la défense de la souveraineté nationale contre toute tentative qui viserait à l'affaiblir.
Jiang Zemin cite à l'occasion un poème de Lin Zexu (1785-1850, vice-roi de Canton, qui fit jeter à la mer l'opium d'importation anglaise) pour illustrer la priorité vitale donnée à la sécurité et à l'intérêt de la nation.
Les menaces dont il est question sont à la fois internationales et intérieures, et leur analyse doit être systématisée : « La sécurité économique est la base, la sécurité politique le principe, la sécurité militaire est l'assurance, la sécurité technologique est la clé, la sécurité culturelle est l'âme, la sécurité de l'information est le centre, la sécurité écologique est la sauvegarde ».
La défense de la souveraineté nationale exige notamment de se méfier du discours tenu sur la primauté des droits de l'homme, lequel vise d'abord à affaiblir la souveraineté chinoise.
Comme Deng Xiaoping l'a dit, la souveraineté l'emporte de loin sur les droits de l'homme. La même tâche exige bien sûr la construction d'une armée forte, laquelle doit être capable - une fois encore - de s'opposer à l'« hégémonisme ».
Les autres dimensions de ce concept intégré de la sécurité nationale sont déclinées de la même façon. L'attention portée à la sécurité culturelle est notable : « La sécurité culturelle consiste à sauvegarder l'excellence de la culture et des valeurs traditionnelles et à éviter qu'il leur soit porté atteinte.
Internet, notamment, est devenu un "nouveau champ de bataille pour la pensée politique", cela notamment du fait du contenu réactionnaire, superstitieux et pornographique qu'il véhicule. »
La « lutte pour assurer la sécurité nationale » concerne donc de façon privilégiée la sécurité de l'information et Internet. Les déclarations sur ce sujet sont nombreuses. En même temps, « assurer la sécurité nationale exige de dépasser le mode de pensée de la guerre froide et de s'efforcer d'assurer une paix internationale durable fondée sur la confiance mutuelle entre les pays et sur leur intérêt commun ».
« Le coeur du nouveau concept de sécurité [internationale], ce doit être la confiance mutuelle, l'intérêt mutuel, l'égalité, la coopération. » C'est sur cette base, on vient de le voir, que sont signées des déclarations établissant des « relations de partenariat » (huoban guanxi) qui échappent au système international antérieur d'alliances et de confrontation.
De façon générale, le ton apaisant des déclarations concernant la sécurité internationale contraste avec le style crispé et méfiant de celles sur la sécurité nationale et sur les interférences extérieures qui la menacent.
Ce contraste constitue sans doute la principale caractéristique du discours chinois concernant la « sécurité » entendue au sens le plus large. Là encore, se reflètent, d'une part, le souci d'assurer un style nouveau et spécifique de grande puissance, de puissance représentant un facteur de stabilité et, d'autre part, l'inquiétude que ce statut soit plus fragile et menacé qu'il n'y paraît de prime abord.
Ces considérations sur la sécurité internationale peuvent être complétées par une lecture des textes émanant des milieux militaires. Xiong Guangkai, chef d'état-major général adjoint de l'APL et en charge de la réflexion stratégique, écrit ainsi : « [Jusqu'à aujourd'hui,] l'hégémonisme et la politique de force subsistent encore, la pensée de la guerre froide et l'unilatéralisme se manifestent souvent ».
La sécurité internationale exige donc d'abord de dépasser ces clivages anciens et d'accepter la diversité des systèmes et des cultures.
La nécessité de dépasser la « pensée de la guerre froide » est rappelée avec insistance. Alors seulement sera-t-il possible de faire face aux nouvelles menaces, le terrorisme en premier lieu.
(À noter que Xiong Guangkai considère que l'explosion de la menace terroriste a eu pour effet d'améliorer notablement les relations avec les grandes puissances - comprendre ici bien sûr les États-Unis.)
Xiong Guangkai développe ensuite les propos de Jiang Zemin sur « la confiance mutuelle, l'intérêt mutuel, l'égalité, la coopération » en les reprenant mot à mot".
De façon globale, l'examen des propos émanant des cercles militaires montre leur adéquation avec ceux provenant des dirigeants politiques. Les différences qui peuvent être notées portent sur l'insistance des militaires quant aux risques persistants de conflits dans le monde, quant aux dangers de l'hégémonisme, et surtout, comme on va le voir dans un instant, quant au degré de probabilité d'un conflit armé sur la question taiwanaise. »…
...:...
Les scénarios stratégiques (p.192) Quels sont, en définitive, les scénarios possibles d'évolution des relations entre la Chine et Taiwan ?
Comme on l'a vu, les facteurs qui interviennent dans l'équation sont multiples : importance symbolique des prises de position sur le statut de Taiwan ; climat politique favorisant ou non le redémarrage de négociations ; intégration économique continue, mais aussi incertitudes apportées par une situation économique beaucoup plus instable que lors de la décennie précédente; processus et conséquences du changement de direction politique à Pékin ; évolution des rapports de force militaire au long d'un processus continu de modernisation et de renforcement ; positionnement géostratégique de la question taiwanaise dans le face-à-face Washington-Pékin et dans l'évolution générale de la région.
Au cours des années à venir, trois situations de base sont envisageables :
a) un conflit militaire ;
b) un accord politique atteint ou en passe d'être atteint ;
c) le maintien du statu quo.
Cinq scénarios sont susceptibles de se vérifier, notamment entre 2007 et 2010
Premier scénario : un conflit militaire se produit. Aucun progrès politique n'a été enregistré durant plusieurs années. L'armée chinoise se sent suffisamment préparée. L'absence de souplesse de la direction du PC chinois a exacerbé les sentiments particularistes ou indépendantistes à Taiwan. L'agitation politique continue d'y régner, et le pouvoir central y est faible. L'engagement des États-Unis, empêtré sur d'autres terrains, est vacillant. Ou, s'il ne l'est pas, l'évolution de la situation diplomatique et militaire d'ensemble (par exemple la mise en place progressive mais encore défaillante de l'initiative TMD) convainc la Chine qu'une action militaire est nécessaire à la défense de ses intérêts vitaux. Justifiée par les stipulations de loi anti-sécession, l'action militaire déclenchée peut être localisée (îles périphériques) ou générale. Si le conflit n'entraîne pas une intervention militaire directe des États-Unis, il aboutit normalement au bout de quelques jours à la défaite militaire de Taiwan. Cette défaite peut s'accompagner du démarrage immédiat de discussions en vue de la signature d'un traité organisant l'unification du pays. Vainqueur militairement, la Chine se retrouve devoir confronter une population en révolte ouverte ou larvée et un problème international majeur.
Deuxième scénario : Taiwan cède à la pression chinoise et l'unification se prépare selon un modèle proche de la formule « un pays, deux systèmes », avec des aménagements d'envergure néanmoins. Une conjonction de facteurs (interdépendance économique avec la Chine continentale jointe à un affaiblissement économique persistant de Taiwan, intensification des échanges au sein de la société civile, fragmentation du paysage politique) favorise l'arrivée au pouvoir de responsables politiques convaincus qu'un accord politique avec Pékin est nécessaire. Ayant perdu le pouvoir, la tendance « taiwanisante » se trouve en position de faiblesse. Une pression opportune de Pékin et l'assentiment tacite des États-Unis favorisent la conclusion d'un accord reconnaissant le principe d'une Chine unique et énumérant les étapes de la réunification. Cet accord, élaboré en référence au modèle « un pays, deux systèmes », mais avec une latitude bien plus grande, prévoit des mécanismes échelonnés sur trente à cinquante ans, avec mise en place immédiate d'étapes préliminaires et symboliques. Cette victoire de Pékin ne doit pas dissimuler que la poursuite du processus est hasardeuse et qu'une recrudescence soudaine du sentiment « particulariste » ou même indépendantiste n'est pas à exclure.
Troisième scénario : Rien n'arrive, statu quo - et cela jusqu'à ce que l'indépendance de facto de Taiwan devienne une réalité incontournable. Taiwan assure pacifiquement une indépendance de facto qui devient de jure. La Chine se recentre sur ses problèmes internes dans un scénario politique qui ne fait pas d'une solution militaire à la question taiwanaise un exutoire possible. L'évolution du rapport de force militaire, à la suite, notamment, d'un engagement renouvelé des États-Unis aux côtés de Taiwan, rend improbable une rapide victoire militaire de l'armée continentale. Le statu quo se prolonge encore une dizaine d'années, au terme de quoi l'indépendance de facto de Taiwan apparaît à tel point comme un fait d'évidence que sa déclaration formelle se produit sans crise majeure. Alternativement (mais avec un degré moindre encore de probabilité), cette déclaration d'indépendance se produit plus tôt, dans un contexte où la Chine continentale n'est pas en position d'intervenir. Après une période de forte tension, la Chine se rend à l'évidence. Cette déclaration facilite peut-être une transition politique à Pékin.
Quatrième scénario : une formule politique inédite voit le jour. La transition politique qui se produit à Pékin, débouche sur un processus d'assouplissement ou même de réformes politiques. Le pouvoir central y reste fort, mais la difficulté d'assurer son autorité l'oblige à emporter des succès visibles. Le dossier taiwanais est à l'ordre du jour. En même temps, un certain nombre de tabous sont remis en cause. Une réforme constitutionnelle s'ébauche, un processus contrôlé de décentralisation est peu à peu mis en place. Les facteurs décrits dans le premier scénario (échanges économiques et civils, incertitudes politiques à Taiwan) restent vrais, mais le résultat des interactions est différent : Pékin assouplit sa position sur le principe et les modalités d'une Chine unique au point de rendre possible une solution de type fédéral, confédéral, Commonwealth ou communauté économique. Une majorité se dégage à Taiwan pour assurer paix et prospérité au prix d'un accord d'association avec la Chine. Cet accord, là encore progressif, garantit l'essentiel de la souveraineté politique, économique et militaire de Taiwan, tout en accordant peut-être au pouvoir pékinois l'initiative en matière diplomatique et en levant la plupart des restrictions en matière de circulation des biens, sinon des personnes (des limitations à l'entrée de continentaux à Taiwan seront probablement maintenues pendant longtemps avec l'accord de Pékin). Une formule politique inédite voit peu à peu le jour, dont l'influence sur l'évolution interne de la Chine continentale elle-même serait sans doute importante. Cette formule repose sur une « complicité » au moins tacite entre les autorités taiwanaises et le nouveau pouvoir pékinois, lequel voit alors dans les concessions faites à Taiwan une façon d'accélérer les changements que lui-même veut réaliser au niveau intérieur. Des oppositions fortes à ce processus, ratifié par référendum, subsistent dans certains secteurs de la population taiwanaise.
Cinquième scénario : statu quo politique intégral. Les relations entre les deux rives passent par des phases de détente et de tensions alternatives. Les échanges économiques et culturels continuent à se développer. Aucune avancée politique n'est enregistrée. En même temps, en raison des pressions parallèles de la Chine et des États-Unis, l'indépendance de jure de Taiwan n'apparaît toujours pas comme un fait acquis ; des secteurs de la population réclament la conclusion d'un accord politique avec la Chine qui fasse droit à la « sinitude » de l'île. Cependant, la société taiwanaise reste divisée et incapable d'élaborer tout consensus réel. La Chine ne renonce toujours pas à l'usage de la force. Ne pouvant déterminer un facteur dont l'influence l'emporterait sur toutes les autres données de la question.
Nous assignons à chacun de ces cinq scénarios une probabilité égale. Cela signifie aussi qu'à l'horizon 2012, et une fois franchie une première échéance critique, nous estimons que les risques d'un conflit armé sont d'environ 20 %, la probabilité du maintien du statu quo avec risque maintenu de conflit d'environ 20 %, et les chances de parvenir à des accords politiques (abstraction faite de leur nature) garantissant une résolution pacifique d'environ 60%. ….
.../... |